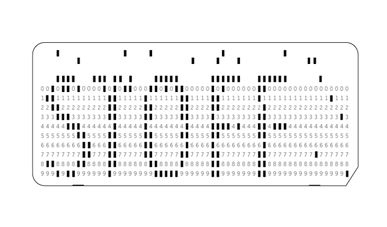La crise des subprimes de 2008, avec son lot d’endettements, de faillites et d’expulsions, a encore une fois réveillé le monstre que le capitalisme ne cesse d’engendrer, l’horizon d’une catastrophe vers laquelle toujours il se précipite et que toujours, il repousse un peu plus loin. Cinq ans plus tard — Detroit, 2013 : la faillite d’une ville entière menaçant ruine, les images d’immeubles vides, de terrains vagues, d’usines abandonnées. Ce désastre n’a rien d’inédit. Il n’est que le dernier ressac d’une longue crise urbaine entamée dès le début des années 1960, éclatant au grand jour avec la rébellion de 1967, s’aggravant dans les années 1970, et conduisant à un irrémédiable déclin. L’ancien Léviathan de la production fordiste n’est aujourd’hui plus qu’une carcasse par deux fois échouée.
La récente catastrophe économique n’eut pas pour seule conséquence d’excaver les décombres des usines de Detroit, livrant un territoire en friche aux amateurs de ruin porn. Elle raviva l’intérêt pour un genre de musique électronique oublié dans le fond des bacs depuis la fin des années 1990 : la techno de Detroit. De ringard qu’il était, dépassé par la vague minimale du nouveau millénaire, le son brut, percussif, et angoissant de la Motor City, enveloppé d’échos rétrofuturistes, suscite l’engouement[1]. Cette techno noire est redevenue, depuis une dizaine d’années, une matrice de la scène électro européenne.
Cette résurgence en contexte de crise est un premier indice de la profonde « négativité » habitant cette musique, qui résonne avec l’expérience subjective d’un monde auquel il n’est plus possible de croire. Ce n’est pas un hasard, en effet, si la techno est née dans l’ancien bastion du fordisme américain, utopie d’un capitalisme conquérant réconciliant ouvriers blancs et noirs sur la chaîne de montage des moteurs automobiles[2]. C’est des ruines de ce monde et de son idéal effondré qu’émerge cette musique, au milieu des années 1980, alors que la classe moyenne blanche a déjà déserté et que la frange la plus pauvre du prolétariat noir[3] est condamnée au crack et à la précarité. Dans ce paysage de déshérence, il faut faire preuve d’une bonne dose d’imagination pour entendre résonner le vacarme industriel qui, il y a plus d’un demi-siècle, battait son plein dans les entrailles de la ville[4]. Vrombissement des fours, percussion des marteaux-pilons, grincement des rails de fret, crissements de la tôle découpée, crépitement des soudures, stridulations des perceuses, visseuses, poinçonneuses hydrauliques et autres outils électroportatifs, vacarme des moteurs intermittents de la chaîne de montage, retentissement régulier des sonneries : les bruits se superposent et se composent en une rythmique millimétrée par la rationalisation fordiste qui parfois s’emballe, s’enraille et s’affole au cri perçant d’une alarme. Si les usines d’assemblage de la Packard, vestiges d’une gloire industrielle passée, sont désormais de simples squelettes de béton de six étages qui s’alignent sur un demi-kilomètre, un dernier sursaut de vie les anima pourtant au début des années 1990. Ce réveil somnambulique ne fut pas l’effet d’une ultime vague d’automatisation. Cela faisait déjà plusieurs décennies que la production avait été délocalisée dans des zones périurbaines pacifiées du Midwest ou dans les nouveaux foyers mondiaux de la main-d’œuvre bon marché. Purement improductif, le son résonna cette fois, non pas au rythme de la chaîne de montage mais de la table de mixage, la technique du sampling se substituant à celle de l’assemblage pour se rebrancher à la mémoire de la ville lors de nuits de rave éphémères. En ce rêve encore vibrant, des corps se jouent d’une aliénation qui leur colle à la peau malgré le passage des générations.
Face à la techno, cet objet musical postfordiste, les outils traditionnels d’analyse esthétique de la Théorie critique s’avèrent impuissants, car périmés. Le vieil Adorno avait déjà fait la sourde oreille au jazz, considéré comme un simple sous-produit d’une industrie culturelle aliénante. La techno n’aurait fait qu’aggraver se surdité. La fonction qu’il assigne aux musiques de l’industrie culturelle, celle d’une intégration adaptative des individus à la société du « capitalisme avancé », correspond au paradigme historique du fordisme et du New Deal, inauguré début des années 1930 et commençant à se fissurer au cours des années 1960. Detroit en est l’emblème. Elle ne fut pas seulement le fief de Ford, mais aussi le berceau de la Motown, célèbre label façonnant tubes et vedettes d’une musique soul positive et réconciliatrice. C’est de l’effondrement de ce modèle, celui de l’ouvrier-consommateur intégré dans une classe moyenne, qu’émerge dans les années 1970 un ensemble de contre-cultures, les mouvements punks et post-punks en Angleterre, puis les musiques électroniques dont la techno au milieu des années 1980. Faut-il alors renverser l’hypothèse adornienne, pour voir dans ces productions contre-culturelles, non plus des rouages de l’aliénation de l’auditeur, mais des leviers de l’émancipation[5] ? Ce serait là s’en tenir à une analyse instrumentale prescrivant à la culture une fonction « politique » avant même d’en étudier le contenu. Une telle démarche prétendument matérialiste n’a pourtant rien d’esthétique puisqu’elle ne s’intéresse ni au contenu des œuvres, ni au vécu de l’auditeur, autrement dit, n’accorde aucune place à l’expérience musicale en tant que telle : pour la techno, le surcroit de jouissance qu’engendre la confrontation du corps dansant avec un son dévastateur, habité par le négatif. À la manière d’Adorno, on pourrait n’y voir qu’un plaisir compensatoire, aliénant toujours un peu plus l’auditeur par l’anesthésie d’une souffrance sociale potentiellement contestataire. C’est justement pour éviter une telle réduction et comprendre ce qui se joue vraiment dans cette musique qu’il convient d’emprunter un détour par l’histoire socioculturelle de Detroit. La démarche ne sera pas génétique, au sens d’une explication causale de la fonction — aliénante ou libératrice — d’un produit culturel à partir des rapports sociaux dont il émerge, elle sera plutôt archéologique. La restitution du contexte socioculturel fournira une clé d’interprétation permettant d’approfondir la compréhension de l’objet, d’en nourrir l’écoute, et d’en déchiffrer le sens. La techno de Detroit apparaîtra ici comme le paradigme d’une création musicale postfordiste, dont la juste interprétation exige d’abandonner un modèle d’analyse obsolète, celui de « l’industrie culturelle » et d’esquisser, en négatif, une nouvelle esthétique critique.

Caractéristique sonore de la techno de Detroit
À l’issue d’une discussion publique, je demandais récemment à Mike Banks (a.k.a Mad Mike), l’un des DJs et producteurs les plus éminents de la scène techno de Detroit, si la musique de son label Underground Resistance (UR) pouvait vraiment être écoutée, vécue et interprétée comme une échappée sonore, une fuite hors de la violence sociale d’un capitalisme en ruine : violence économique du chômage massif, violence raciste de la police, violence institutionnelle de la ségrégation urbaine, toute une accumulation de violence qui plonge ses racines dans la longue histoire de l’essor et de l’effondrement du modèle d’intégration ouvrière caractérisant la ville de Detroit. Avec ses élans cosmiques et futuristes[6], tout semble opposer cette techno au rap de la rue, terre à terre, porte-parole de la condition urbaine des prolétaires du « ghetto », de la misère quotidienne, des dangers de l’économie informelle, de cette violence intériorisée qui éclate dans la rage des mots.
Au lieu de me répondre directement, Mike Banks me lança en guise de défi : « Tu sais, moi je ne théorise pas ma musique, je la fais, voilà tout. Si tu cherches un sens, tu n’as qu’à écouter les machines. Ce sont elles qui te diront, pas moi. » Attitude révélatrice du retrait du DJ derrière son outillage technologique, animé de sa vie propre, dont il n’est que le catalyseur, le passeur, et non pas l’auteur ou le créateur. Mutisme redoublé des machines qui se refusent à nous livrer un récit riche de sens, plein d’âme, soulful. Il est vrai, la techno ne raconte aucune « histoire », contrairement aux fables réconciliatrices de la soul ou aux récits prosaïques du rap. Il est tout aussi vrai qu’elle ne déploie aucune narration harmonique, à la différence de la house de Chicago — sa cousine électronique — construisant des lignes mélodiques sur fond de variations, de tensions et de résolutions d’accords[7]. Ce n’est pas pour autant qu’elle n’ait rien à nous dire.
[INTERMÈDE : « The Art of Stalking », DJ Suburban Knight]
Tâchons de suivre le conseil de Mike Banks et faisons parler l’objet, ou plutôt, laissons-le s’ébruiter. Le titre « The Art of Stalking » du DJ Suburban Knight (James Pennington), produit en 1990 juste avant la création du label Underground Resistance auquel il participera, peut s’écouter comme un échantillon révélateur de la techno de Detroit, au moment où elle commence à se distinguer de la musique house de Chicago en abandonnant toute ligne mélodique pour se construire dans la pure répétition rythmique. Ce morceau d’une composition extrêmement simple se compose d’un assemblage de lignes de percussion et de basse qui se superposent et s’entrecroisent progressivement, assemblage ponctué par trois notes qui résonnent au loin comme l’appel lancinant d’une alarme. Au lieu de les combiner pour construire une architecture rythmique cohérente de plus en plus complexe, le DJ semble les faire jouer les unes avec les autres, en déclinant toutes les combinaisons possibles afin de laisser résonner la texture du son, qui vibre, frise et se dédouble en échos métalliques. À travers ces modulations se dégage la spécificité d’un battement intermittent, frappant un temps sur deux, qui rappelle le pilon d’une presse à air comprimé s’abattant sur une surface métallique avant de se rétracter. Par un travail du rythme et de la matière sonore, ce morceau reconstitue, à sa manière, l’ambiance d’une usine d’assemblage automobile. Alors que la chaîne de montage impose un enchaînement nécessaire, soumettant la confection de la marchandise à un plan d’efficacité rationnelle, le bricolage musical en est un détournement ludique. Le DJ n’assemble les différentes boucles que pour mieux pouvoir les décomposer et les recomposer, en ouvrant un espace de jeu pour l’auditeur-danseur. Les différentes lignes rythmiques ne s’enchaînent pas en un développement temporel délimité par un début et une fin — la piste semble bien pouvoir continuer indéfiniment. Elles se superposent plutôt pour construire un espace tridimensionnel, une accumulation de strates que l’auditeur est libre de pénétrer. Chaque sample n’est qu’une unité simple, un « musème »[8] répété à l’identique tout au long du morceau. Chaque rythme est une loop, boucle se refermant sur elle-même. Leur valeur sonore ne dépend plus uniquement de leur enchaînement temporel — qu’ils soient lancés au début ou à la fin de la piste, ils restent quasiment identiques à eux-mêmes. Cette valeur est plutôt fonction de leur position respective, à chaque fois relative aux autres sons, et notamment à la profondeur de champ qui les rapproche ou les éloigne de la ligne de basse, le kick fondamental. Le principe d’évolution temporel, qui guide la composition traditionnelle de la musique harmonique, est ici intégré dans une spatialisation du son[9]. Plutôt que de porter un « message » qu’il faudrait décrypter dans une certaine narration sonore, cette musique trace la carte d’un champ sensoriel que l’auditeur peut explorer à sa guise. L’écoute n’est qu’un moment de cette exploration spatiale, qui s’effectue par l’esquisse d’une série de mouvements potentiels, autant de virtualités que le corps peut ensuite habiter par la danse[10].
Choisir un morceau tel que « The Art of Stalking » (1990), composé d’un assemblage répétitif de bruitages industriels, pour en faire un exemple paradigmatique de la techno de Detroit, c’est déplacer, ou plutôt retarder, le récit traditionnel de sa genèse qu’on retrouve souvent retracée sous forme d’une success-story dans les documentaires ou les récits uniquement biographiques du genre[11]. On y raconte que la techno de Detroit, contrairement à la rave électronique européenne plus tardive, serait encore animée d’un balancement funky de la rythmique et ornée de lignes mélodiques jazzy. C’est là en effet une caractéristique bien marquée de la musique de la première génération des DJs de Detroit — Juan Atkins, Kevin Saunderson et Derrick May — ceux qu’on a appelé du nom de leur suburb les Belleville Three en référence aux Big Three, les trois magnats de l’industrie automobile de Detroit que sont Ford, Chrysler et General Motors. Lorsqu’ils commencent à expérimenter dans leur garage, tous trois sont encore au lycée, où viennent de commencer des études. Fils de techniciens et d’ouvriers qualifiés, ils appartiennent à ce segment de la classe ouvrière noire de Detroit épargnée par longue crise industrielle, et pouvant bénéficier d’un minimum de ressources pour investir dans des boîtes à rythmes et des synthétiseurs bon marché[12]. On ne peut nier l’influence décisive qu’ils ont exercée durant une première décennie (1981-88) sur le développement de la musique électronique au sein de la ville, leurs tracks étant d’abord diffusées dans des clubs branchés de lycéens de classe moyenne (les preps) avant d’être projetées au sommet des classements pop par un producteur anglais : Neil Rushton. L’appellation du genre fut d’ailleurs définitivement intronisée par la célèbre compilation Techno! The New Sound of Detroit, parue chez le grand label Virgin en 1988, couronnant ainsi cette première période de création par un succès international. Mais la plupart des titres, notamment ceux ayant rencontré le plus grand succès comme « It is what it is » de Derrick May (a.k.a Rythim is Rythim) ou « Big Fun » de Kevin Saunderson (a.k.a Inner-City), empruntent encore la plupart de leurs éléments rythmiques ou mélodiques à la musique house de Chicago de la même période[13] : rebond dans un beat rendu par des contretemps et des battements syncopés, qui mêle encore des timbres de percussions aux sonorités électroniques ; incorporation d’harmonies jouées par des ensembles symphoniques de cordes ; refrain aux envolées lyriques chanté par une voix chaleureuse. Rien d’étonnant, donc, que le premier titre envisagé pour cette compilation ait été The House sound of Detroit, assimilant le son de cette ville à l’une des variantes de la musique électronique la plus en vogue durant les années 1980.
Parmi les Belleville Three, c’est peut-être Juan Atkins qui explora la voie la plus originale. L’irruption musicale du mot techno dans le titre « Techno City » remonte à son premier projet Cybotron (1981-85) en collaboration avec un musicien rock, Richard Davis, qui se fascine pour la théorie futuriste d’Alvin Toffler[14] inventant le concept de « Techno Rebel ». C’est dans son projet solo (Model 500) que Juan Atkins inaugure véritablement une musique inédite. Le titre « No UFOs » de 1985 fait entendre pour la première fois la rigidité de cette rythmique à quatre temps, ornée de bruitages robotiques, de boucles mélodiques incessamment répétées contre toute progression harmonique, et ne recourt à la voix humaine que pour la fragmenter et la distordre.
[INTERMÈDE : « Goodbye Kiss », Eddie Fowlkes]
C’est également sur son label Metroplex que parut en 1986 l’un des titres les plus novateurs repris sur la compilation Techno! : « Goodbye Kiss » de Eddie Fowlkes, un jeu de déconstruction du lyrisme en guise d’adieux à la house de Chicago. On y entend s’affronter deux principes antagonistes : d’une part la conjonction d’un beat puissant et d’une ligne de basse aux accents métalliques, d’autre part une légère mélodie à la flûte unie à un sample vocal aux accents de romance : « At least I could give you a goodbye kiss ». Par une série de modulations électroniques de plus en plus audacieuses — bégaiement frénétique par l’usage du scratch, dédoublement des fréquences par une variation du pitch, distorsion du timbre jusqu’à l’aboiement, Fowlkes fait dérailler la voix, comme sur un vieux disque qui n’en finit pas de sauter. Ces bribes robotiques ne se perdent pas simplement dans le non-sens de la répétition, elles se fondent littéralement dans la matière sonore. La voix se fait bruit, nouvelle touche d’un paysage sonore hybride, à mi-chemin du haut-fourneau et de l’usine cybernétique. Cette torture électronique, d’une inventivité provocante, se clôt sur une victoire du principe technoïde. Seuls le beat et la basse résonnent encore à la fin du morceau ; la mélodie elle-même s’est éteinte, désactivée par cet ébruitement de la voix. Blake Baxter, qui reprend le même principe de composition dans son titre paru sur la même compilation de 1988, « Ride Em’ Boy », commente d’ailleurs son projet comme un abandon de la tradition lyrique afro-américaine : « Je ne chante pas vraiment. […] Je parle d’une voix douce presque dissimulée derrière le beat […] Cela n’a rien à voir avec le chant gospel. »[15]
Plutôt que de chercher la spécificité de la techno de Detroit dans une hybridation des premières musiques électroniques avec une tradition musicale afro-américaine, comme cela a pu effectivement être le cas dans la house de Chicago, il faut donc la définir comme une musique noire rompant définitivement ses attaches avec le lyrisme et la positivité d’un humanisme réconciliateur de la soul, pour embrasser directement sa négation par la machine. C’est un son postsoul, comme l’affirme à juste titre Stuart Cosgrove dans un article pour la revue The Face[16], hypothèse qui sera reprise et développée par Kodwo Eshun dans son interprétation magistrale de la trajectoire futuriste de l’avant-garde musicale noire de son ouvrage More Brilliant than the Sun[17]. Contre la citation galvaudée de Derrick May définissant la techno comme « la rencontre de Kraftwerk et de George Benston dans un ascenseur », il faut insister avec Juan Atkins sur le principe de rupture qui l’anime : « Pour faire simple, ça nous saoulait d’entendre toujours parler de rencontres ou de séparations amoureuses, le système R&B nous saoulait, et c’est pourquoi un nouveau son progressiste a émergé. On l’a appelé techno ! »[18] Avec Juan Atkins, cette rupture postsoul et machinique ne fait que s’esquisser. Elle prend forme chez quelques figures marginales de la première génération des DJs de Detroit. Mais ce sera la création du label « Underground Resistance » (UR) par Mike Banks et Jeff Mills, initiant une seconde vague techno au début des années 1990, qui finira par l’accomplir.
Que retenir de cette description immanente du contenu musical d’une techno à la recherche de sa signature sonore ? Ses traits caractéristiques sont les suivants : la mise en place d’une rythmique à quatre temps au beat régulier, dotée d’une résonnance industrielle ; une substitution des bruitages électroniques et synthétiques aux sons naturels des instruments et de la voix ; une annulation de la narration linéaire remplacée par une spatialisation des sons aux potentiels multiples. Pour apprécier la signification de cette reconfiguration postsoul de la musique électronique de Detroit, on ne peut s’en tenir à une analyse comparative soulignant des différences esthétiques entre la house et la techno. Seule une interprétation contextuelle peut permettre de comprendre le sens de cette différence, en empruntant un détour par l’histoire culturelle et sociale de la ville.

La bande-son de la crise
Cette ville est totalement dévastée. Elle subit le plus grand changement de son histoire. Detroit traverse sa troisième vague, une dynamique sociale qu’aucune personne extérieure à cette ville ne peut comprendre. Les usines ferment, les gens partent à la dérive et les gamins se butent juste pour se marrer. L’ordre tout entier s’est effondré. Si notre musique est la bande-son de tout ça, j’espère qu’elle peut faire comprendre aux gens ce qu’est la désintégration à laquelle on fait face. — Derrick May[19]
Le sens de la rupture de la musique techno de Detroit avec l’héritage soul, qu’on entend encore résonner dans les grands tubes de la première génération des années 1980, dépasse largement la volonté de se distinguer de la house de Chicago. Comme l’indique le DJ Blake Baxter, la ligne de faille passe au sein même de l’héritage musical de Detroit : « Ne nous appelez pas la nouvelle Motown […] Nous sommes un second avènement »[20]. Si la comparaison avec la house de Chicago permet de délimiter la techno de Detroit au sens strict et d’en produire une définition, c’est cette volonté de se distinguer avec l’héritage musical de sa ville d’émergence qui permettra d’interpréter la signification sociale de cette musique, sa teneur d’expérience.
La Motown, cette maison de disque mythique originaire de Detroit fondée en 1959, qui prospéra dans les années 1960, s’empara de la tradition du gospel pour inventer la soul, comme renouvellement de la musique afro-américaine populaire destinée à une diffusion à grande échelle. Son père fondateur, Berry Gordy, transposa la figure de la vedette blanche du cinéma hollywoodien dans celle de la star noire, dont l’allure, les gestes, les intonations, furent calibrés pour produire l’effet le plus séduisant possible sur le grand public américain. Qu’on pense aux chorégraphies millimétrées des Jackson Five, ayant révélé le jeune Michael, ou encore aux sourires rayonnants des Supremes, trio de Diana Ross. Par cette mise en scène spectaculaire, la représentation de l’identité noire est ainsi rendue présentable, assimilable à la communauté nationale. À l’époque des luttes pour les droits civiques, Martin Luther King qui organisa en 1963 une grande marche à Detroit célébra la musique produite par Berry Gordy comme étant un facteur d’« intégration émotionnelle » du peuple noir dans la Nation américaine, qui devrait précéder leur « intégration intellectuelle »[21]. Mais au-delà d’une réconciliation des peuples transparaissant dans les stratégies de marketing musical, la soul de la Motown élabore souvent un discours lyrique de célébration de la réalité existante. L’imaginaire religieux de la réconciliation chanté par le gospel comme un avenir messianique se voit transposé dans le monde d’ici-bas par l’affirmation de la vie immédiate, l’amour apparaissant comme le salut individuel accessible à tout un chacun dans la simplicité du quotidien[22].
L’émergence de cette musique apologétique au plein cœur de Detroit de la fin des années 1950 a quelque chose de paradoxal au vu du déclin industriel, résultant d’une série de crises économiques qui frappent la ville de plein fouet. Suite aux vagues successives d’automatisation et de délocalisation des chaînes de montage, la production industrielle accuse une perte de 134 000 emplois entre 1947 et 1964, principalement dans les postes de manouvriers les moins qualifiés, faisant chuter le nombre d’emplois dans ce secteur à près de la moitié de son niveau maximal, atteint au sortir de la Seconde Guerre mondiale. L’exemple le plus significatif de cette récession est le démantèlement progressif du complexe industriel Rouge de Ford, dont les différentes branches de production furent progressivement délocalisées dans des usines automatisées du Midwest, plus spécialisées et moins vulnérables aux grèves ouvrières organisées. Alors qu’elle employait près de 85 000 ouvriers au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ce chiffre chute à 30 000 au début des années 1960. Les effets dévastateurs de cette crise économique touchent tout particulièrement les ouvriers noirs, qui ont fui la ségrégation du Sud des États-Unis en masse pour trouver à s’employer dans l’industrie automobile qu’on leur fit miroiter comme un nouvel Eden. Des politiques salariales structurellement racistes leur réservent les postes de manouvrier les moins qualifiés et les plus susceptibles de sauter lors des vagues d’automatisation successives[23]. Nous voilà loin de l’idéal d’une intégration par le travail industriel promise par le fordisme. Sous les conditions socio-économiques d’une crise aggravée, la production musicale de la Motown accuse un profond écart avec l’expérience sociale des prolétaires noirs vivant à Detroit, caractérisée par la violence structurelle d’une exploitation accrue du travail pour les ouvriers ayant pu conserver leur poste, et du chômage à long terme ou de la précarité pour les autres, laissés sur le carreau. On ne peut bien évidemment pas réduire le contenu esthétique de la soul à la dissimulation apologétique de cette expérience de la violence, et l’on peut comprendre sa positivité comme une aspiration au bonheur elle-même produite par la dureté de ces conditions. Il ne s’agit pas ici de dénoncer ou de rejeter la valeur esthétique de cette tradition musicale à l’aune d’un critère de conformité au réel, mais plutôt de comprendre les raisons d’une rupture progressive avec cet héritage animant la techno de Detroit.
Ce tournant postsoul, distinguant la techno de Detroit de la house de Chicago, signe la rupture avec cette célébration de la vie et cet idéal d’une réconciliation des peuples dans une même expérience de l’amour ou du succès économique. Si l’idéal est rejeté, c’est parce qu’il est devenu impossible de croire à sa réalisation dans les conditions historiques du capitalisme en crise reposant sur une domination raciale[24]. Cette rupture esthétique se manifeste, en regard de l’histoire de la ville, comme la confrontation avec une rupture historique antérieure : l’éclatement de la Grande rébellion de l’été 1967, ces émeutes urbaines de cinq jours embrasant les quartiers noirs du centre-ville, qui furent écrasées dans une répression sanglante. Bilan : 43 morts (dont 40 victimes des balles de la police ou de l’armée), 7231 arrestations, et 2500 bâtiments brûlés[25]. La violence de la répression policière et militaire des populations excédentaires, laissées sur le carreau et parquées dans des ghettos, vient redoubler la violence économique accrue de l’exploitation et du chômage de masse. Alors que la Motown délocalisa ses studios à Los Angeles peu de temps après les émeutes de 1967, qui éclatèrent en même temps que son grand congrès annuel, la musique d’Underground Resistance fait résonner, vingt-cinq ans plus tard, une remémoration sonore de ce passé. Lorsqu’ils commencent à bricoler des sons dans leurs garages, le souvenir de cette crise habite encore la mémoire des DJs de Detroit, comme Jeff Mills qui raconte avoir dû fuir avec sa famille le quartier où ils habitaient, centre névralgique des émeutes, pour passer une semaine au Canada le temps que le calme retombe sur la ville[26]. Dans les premiers titres d’Underground Resistance sur lesquels il se fait connaître, on peut entendre l’alarme qui hurle sur fond de la clameur des rues comme un avertissement sonore, dénonçant tout élan de lyrisme positif qui souhaiterait faire vibrer à nouveau la fibre soul de la Motown après ces événements. Mais loin de toute affliction, de toute désolation face à la violence sociale, le Riot EP, l’une des premières productions du label en 1991, déploie le cycle des affects de l’émeute (Riot, Panic, Rage, Assault). Cette mise en scène sonore renverse la violence subie, réprimée, refoulée — double violence de l’exploitation capitaliste et de sa répression policière — en une puissance potentiellement contestatrice[27].
Comme l’atteste le décalage historique entre la longue crise des années 1960-70 et la genèse de la techno au tournant des années 1980-90, la confrontation à la violence ne se déploie pas comme un jeu de miroir entre la réalité sociale et l’expérience musicale. Elle se joue en différé, par la subversion d’un héritage soul encore vibrant dans les premiers hits technos des Belleville Three. La dureté implacable des rythmes s’impose comme un antidote contre l’oubli, voire le déni, qui anime les élans réconciliateurs des grands titres à succès de la première génération de DJs de Detroit des années 1980. Le meilleur exemple de ce geste subversif est un des premiers titres de Jeff Mills qui, bien que méconnu, peut être considéré comme le point de rupture inaugural de la deuxième vague de la techno de Detroit. Après avoir forgé sa culture musicale et son expertise technique comme animateur radio talentueux durant plusieurs années sous le nom de Wizard, et avant de fonder le label Underground Resistance (UR), Mills se lance comme batteur et DJ dans un projet d’électro industrielle du nom de Final Cut, en collaboration avec Anthony Srock.
[INTERMÈDE : « Open Your Eyes », Deep In 2 the Cut, Final Cut]
On peut écouter le titre « Open your Eyes », rappelant les sonorités brutales des groupes post-punk européens[28], comme un détournement provocant du plus gros hit produit par la génération précédente, le célèbre « Good Life » de Kevin Saunderson qui gravit la 4e place du top 50 anglais en célébrant une vie simple glorifiée par l’amour dans la plus pure tradition soul : « Love is shining. Life is thriving in the good life. Good life […] No more bad times. Only glad times in the good life ». En reprenant cette affirmation positive — « This is a Good Life », pour la juxtaposer à l’injonction — « Open your eyes », suivie de rythmes coups de poing doublés d’une ligne de basse étouffante et d’un mitraillage de caisse claire, Mills élabore une stratégie sonore redoutable pour retourner le gant de l’idéologie : ouvrir les yeux sur la violence sociale qui déchire la ville de Detroit, non par une représentation directe de son objet, mais par un renversement des représentations apologétiques qui animent son héritage musical. Il ouvre ainsi la voie à une esthétique sonore négative qui sera pleinement déployée par les productions plus tardives d’Underground Resistance (UR).
Même si les DJs d’UR développeront une mise en scène militante en s’inspirant du groupe de hip-hop Public Ennemy, il est pourtant difficile de leur faire porter un discours qui aurait immédiatement une visée politique. Il s’agit plutôt pour eux d’articuler un ensemble de pratiques autour de leur nouvelle production sonore — iconographique, scénographique et éditoriale — pour prendre position de manière critique au sein du champ culturel lui-même. Ainsi, l’anonymat cultivé par le retrait du DJ, cagoulé derrière ses platines et encodé par des pseudonymes aux résonances robotiques, est le symbole d’une contestation du régime de la vedette de la tradition soul américaine et de son extension dans le monde des musiques électroniques. De même, leur résistance ne se joue pas directement sur la scène politique de l’émancipation mais se déploie sur le terrain de la production musicale, en se dirigeant contre les grands labels, ces majors qui réduisent l’objet musical à une marchandise potentielle pour l’évider de son contenu antagonique. Cette lutte n’en est pas moins réelle et matérielle, puisqu’elle requiert l’acquisition d’un ensemble de moyens de production à une échelle locale. Les antiques presses de vinyles de l’industrie du disque de la Motown connurent une nouvelle vie à la fin des années 1980 grâce à Ron Murphy, un ingénieur du son qui inventa un ensemble de techniques pour les mettre à disposition des DJs de Detroit, en constituant une signature sonore unique à la nouvelle musique électronique[29]. L’autonomie revendiquée de la production musicale requiert également des canaux autonomes de diffusion qui contrecarrent les stratégies des grands labels[30]. Et cette lutte, interne au champ culturel, n’est pas sans lien avec des problématiques immédiatement politiques, comme en témoigne l’EP n° 23, de 1992, intitulé « Message to the Majors », mais affichant sur l’autre face « Message to all murderers on the Detroit Police Force - We’ll see you in hell! Dedicated to Malice Green »[31]. Par ce jeu de renvoi, la mise en scène iconographique de l’EP indique que la violence policière du quotidien, fondée sur une domination raciste, est le revers d’une certaine hégémonie économique des majors dans la production musicale. Il s’agit bien évidemment d’un geste provocateur, mais il peut nous guider sur la voie d’une interprétation féconde selon laquelle un certain modèle de production musical — la soul affirmative et réconciliatrice des majors — tend négativement à dissimuler la violence réelle de l’oppression, par une adhésion à la logique marchande qui prône la célébration du monde existant. À l’inverse, la musique techno peut donc être écoutée, dans son tournant industriel et vindicatif de la deuxième vague d’Underground Resistance, comme une confrontation indirecte à une forme de violence de l’expérience urbaine de Detroit qui fut passée sous silence par la tradition soul de la musique de la Motown.
Une telle analyse suppose que la création musicale soit le prisme d’une expérience sociale, dont elle porte la trace sans toutefois la représenter. Face à la musique électronique, on pourrait être tenté de restituer le « contenu social » à partir de la valeur mimétique de certains sons empruntés au travail industriel, aux chaînes de montage, à l’environnement urbain. Mais s’en tenir là, ce serait toutefois s’empêcher de saisir le sens du geste créatif proprement dit, qui ne se contente jamais de refléter une réalité première dont il serait dérivé. Si des sons préexistants sont employés, c’est toujours pour être insérés dans une totalité expressive qui leur donne un certain sens : non seulement le morceau individuel, mais aussi l’horizon musical plus large dont il est issu. Cette signification doit être dégagée par un travail d’interprétation, qui procède par la comparaison de différents imaginaires sonores portant, du fait de l’histoire complexe de leur production et de leur réception, des connotations affectives singulières. Si la culture peut jouer parfois le rôle d’une représentation symbolique du monde social, elle est avant tout un tissu d’expériences bien réelles en lesquelles se cristallisent les aspirations des individus face au monde, leur position subjective au sein du réel, leurs angoisses et leurs espoirs. C’est donc l’analyse archéologique ici proposée, soulignant la subversion, voire l’annulation, de l’élément soul présent dans l’héritage musical de Detroit, qui permet de restituer cette teneur d’expérience cristallisée dans la techno.

L’écho dystopique du fordisme
Si la techno de Detroit met bien en scène une confrontation à la violence sociale, ce n’est donc pas tant par la construction d’une photographie sonore restituant fidèlement une réalité cachée ou déniée par l’industrie culturelle, que par un travail de subversion interne à l’horizon culturel et musical de la ville. La réalité sociale n’est donc pas immédiatement reflétée mais plutôt réverbérée dans l’élément de la réalité musicale, en étant toujours déjà médiatisée par une tradition culturelle construisant des associations entre certains éléments sonores et des moments de la vie sociale. Une telle analyse permet de rendre compte du décalage historique entre l’expérience sociale dont la techno se fait l’écho — la crise du modèle de production fordiste des années 1950-60 — et l’époque plus tardive de sa genèse musicale, au tournant des années 1980-90, alors que la crise est déjà consommée et que la vie urbaine en déclin n’est plus qu’une survivance résiduelle de la grande époque industrielle. En suivant cette démarche, on peut réinterpréter le contenu social de la techno de Detroit comme une déconstruction sonore du grand récit du fordisme. Par fordisme, il faut ici entendre une réorganisation sociale de la production capitaliste fondée sur l’intégration des travailleurs salariés dans la consommation de masse. Le rêve fordiste de l’ouvrier conduisant le modèle standardisé de la Ford T qu’il assemble lui-même sur les chaînes de montage correspond à une nouvelle socialisation, dans laquelle il se voit contraint à ne consommer que des marchandises pour sa propre subsistance. Et cette intégration de la reproduction de la force de travail dans la production marchande est rendue possible non seulement grâce à la hausse des salaires, mais aussi par la prise en charge de leurs conditions de vie par des institutions étatiques et syndicales instituées par le New Deal. Les usines Ford de Detroit représentent dès les années 1930 le lieu de naissance de ce modèle social, rendu possible par la hausse de productivité du travail industriel sur les chaînes de montage. Elles seront quarante ans plus tard l’épicentre de son effondrement.
[INTERMÈDE : « The Workers », Waveform Transmission, Jeff Mills]
Lorsque les DJs d’UR reconstituent l’atmosphère sonore du travail à la chaîne, caractéristique de la production fordiste avant son démantèlement par des vagues d’automatisation successives, il ne faut pas y entendre la remémoration nostalgique de la gloire de l’industrie automobile passée. Qu’on prenne par exemple un titre évocateur de Jeff Mills, paru en 1994 sur le troisième disque de sa série Waveform Transmission et intitulé « The Workers ». Il s’agit bien ici d’une musique-bruit, dont la rythmique frénétique est presque exclusivement composée de sonorités de l’usine : le kick est d’emblée ponctué par un cliquetis en contretemps, qui rappelle les translations intermittentes de la chaîne, sur lequel s’ajoute par couches successives une vibration haute fréquence évoquant le travail d’une poinçonneuse et les hurlements stridents d’une scie à métaux. Dans cette reconstitution mimétique des sonorités du travail industriel et cet agencement rythmique des bruits de l’usine, la techno semble renouer avec le projet futuriste de Luigi Russolo qui appelait, en 1922, à inventer une nouvelle musique en phase avec l’environnement sonore de l’individu urbain moderne : « Aujourd’hui l’art musical recherche les amalgames de sons les plus dissonants, les plus étranges et les plus stridents. Nous nous approchons ainsi du son-bruit. Cette évolution musicale est parallèle à la multiplication grandissante des machines qui participent au travail humain. »[32] Alors que le projet futuriste, louant le progrès d’une nouvelle modernité industrielle, avait pour but de recomposer une totalité harmonique à partir de ces bruits dissonants, pour adapter l’individu à son nouvel environnement sonore et lui permettre d’en faire l’expérience comme totalité cohérente[33], le morceau de Jeff Mills s’attache à exacerber la violence de ces sonorités, qui s’enchaînent et s’amplifient en une saturation assourdissante perdant l’auditeur dans une confusion de bruits. Comme dans un travail à la chaîne, le corps dansant est soumis par cette musique à un enchaînement de rythmiques de plus en plus rapides jusqu’à atteindre ce point ultime de décrochage (3 m 07s) où la machine déraille. Loin de toute glorification du travail industriel, il s’agit ici d’une mise en scène de l’accélération incessante des cadences écrasant les corps, stratégie d’exploitation qui fut sans cesse dénoncée par les syndicats comme un moyen d’extraire toujours plus de profit sans investissement supplémentaire. La simple reproduction acoustique du paysage sonore des chaînes de montage en cours d’automatisation n’est ici qu’une apparence. S’il y a bien une valeur mimétique de la techno, reposant sur la texture matérielle des sons qu’elle emploie, leur agencement rythmique repose sur un effet d’accélération et de saturation qui souligne la violence sous-jacente de l’exploitation imposée par la machine sur les corps. La mimesis n’a ici rien d’une glorification du réel ; elle en est l’image inverse, en négatif. En tant qu’elle approfondit les tensions sonores au lieu de les résoudre, la techno s’éloigne de toute exaltation futuriste d’une réalité industrielle en voie d’automatisation. En elle résonne l’implosion sonique de cet idéal.
Par sa réverbération rétrospective du passé industriel de la ville, la musique techno suggère donc la fausseté illusoire de l’idéal du fordisme, basé sur l’intégration du prolétariat dans la « Good Life » du rêve américain, idéal qui rayonne par exemple dans un documentaire promotionnel pour la candidature de la ville de Detroit aux Jeux Olympiques de 1968, réalisé en 1965. Deux ans avant l’éclatement des émeutes, on y entend la voix chaleureuse du maire de la ville chanter les louanges d’une cité nouvelle, havre de paix pour l’intégration de tous les peuples par la prospérité économique et le développement industriel. « Souvent dénommée la ville la plus cosmopolite du Midwest, Detroit se tient aujourd’hui sur le seuil d’un futur totalement nouveau, un futur plein de promesses et de réussite. […] Ici, des peuples de nombreuses nations se sont rencontrés, se sont mêlés et ont construit une métropole où fleurissent le commerce et la culture. »[34] Au mythe d’un éclatant succès du fordisme à Detroit succède un autre mythe, toujours en vogue aujourd’hui, celui d’un soudain déclin de la ville causé par les émeutes de 1967, point de départ d’une longue décadence liée à l’insoumission des populations noires.
Cette reconstruction idéologique dissimule la profonde ségrégation raciale qui sous-tendait, dès le départ, le modèle fordiste de production. La longue crise industrielle des années 1950-60 est aggravée par une profonde contradiction raciale : alors que les populations noires émigrant massivement vers Detroit pour fuir la ségrégation des États du Sud espéraient profiter de la prospérité économique de cette ville, elles se retrouvent soumises à une double ségrégation économique et géographique, parquées sans travail dans des ghettos toujours plus insalubres. L’Éden qu’on avait fait miroiter aux prolétaires noirs se révèle être un enfer, non pas simplement par la dureté de l’exploitation au sein du travail à la chaîne, mentionnée auparavant, mais par l’exclusion pure et simple d’un travail salarié dont dépend une vie décente[35]. Le destin du quartier portant ironiquement le nom de « Paradise Valley » témoigne de cette contradiction entre l’espoir d’une vie meilleure et l’expérience de la plus grande misère. Fondé dans les années 1930 pour loger les populations noires arrivant par dizaines de milliers, il devient à la fin des années 1950 l’un des ghettos les plus ségrégés, avec le taux de chômage le plus élevé de la ville, avant d’être rasé dans les années 1960 par des projets de restructuration urbaine et de construction d’autoroute aggravant encore la précarité de ses habitants.
[INTERMÈDE : « Cosmic Cars », Cybotron]
Lorsque les DJs de Detroit se ressaisissent de l’imaginaire utopique nourri par le progrès industriel et technologique, ce même imaginaire qui avait suscité les représentations idéalisées de la ville jusqu’à la veille des émeutes de 1967, c’est presque toujours pour le mettre à distance, en souligner l’ambivalence, voire le renverser complètement en son contraire dystopique. Dans l’un des premiers titres de la première vague techno de Detroit, le « Cosmic Cars » de Cybotron paru en 1982, on entend la voix lancinante de Juan Atkins qui tente de se rattacher à l’imaginaire futuriste des voitures volantes, rêve de la production fordiste, pour s’arracher à la misère du quotidien[36]. Ces paroles sont scandées sans aucune conviction, animées d’une conscience mélancolique de la vacuité d’une utopie obsolète, d’un passé déjà enterré. Dans le titre de Jeff Mills « Utopia », paru sur son nouveau label Axis en 1994 au sein de l’album expérimental Cycle 30, cette mise à distance du rêve fordiste s’accentue pour finalement s’inverser en son contraire. Le morceau s’ouvre sur une succession de basses angoissantes et saturées, tandis que les quelques sonorités ludiques qui s’égrènent par la suite sont vite rattrapées par l’agitation inquiète d’une mélodie au synthétiseur et le roulement d’une rythmique évoquant un effondrement. La ville de Detroit prospère et flamboyante qui nourrit l’imaginaire américain du fordisme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale n’a jamais existé : c’est une utopie, au sens propre du mot, un non-lieu dont il faudrait retracer la carte dans l’imaginaire idéologique. Du passé fordiste, du rêve américain de l’intégration ouvrière par la consommation, de l’unification des noirs et des blancs dans le travail salarié, il n’y a rien à sauver. L’utopie promise se dévoile, dans l’après-coup, comme dystopie réelle. La techno n’est donc pas seulement le prisme sonore de l’effondrement du fordisme. Elle est une mise en scène rétrospective des potentialités dystopiques ayant fissuré, dès le départ, cet édifice social. Contre le mythe d’un âge d’or soudain brisé par les émeutes de 1967, elle élabore un contre-récit, une déconstruction de l’utopie.
Cependant, ce renversement n’annule pas entièrement toute possibilité d’investir un horizon utopique original. La techno de Detroit, même dans sa seconde vague, ne se contente pas de confronter l’auditeur à des affects angoissants en l’exposant à un son brut, répétitif, potentiellement désagréable. Elle reste bien animée d’un élément de positivité, qui jaillit momentanément dans certains titres sous la forme d’une rythmique funk syncopée, ou d’une ligne mélodique pleine d’allant. Mais contrairement à la house de Chicago, elle arrache cet élément de la positivité du monde social existant pour le projeter dans un horizon radicalement hétérogène : l’univers cosmique de la conquête spatiale, qui devient une toile de fond sur laquelle l’expérimentation sonore peut tracer librement des paysages nouveaux. Après une première série de titres mettant en scène les émeutes urbaines et la violence policière de Detroit, le label UR produit dès 1992 les EPs World 2 World et Galaxy 2 Galaxy, dont le remarquable titre « Jupiter Jazz », qui renoue certainement avec une certaine tradition soul de la musique de Detroit en la transposant dans un univers infiniment lointain. Cette reconfiguration spatiale de l’utopie se prolonge la même année dans l’une des recherches sonores les plus abouties de toutes les productions du label : l’album expérimental Discover the Rings of Saturn[37], entraînant l’auditeur dans une gravitation sonore. Chaque piste trace sur le vinyle un sillon dont l’épaisseur, relative à sa durée, est proportionnelle à la dimension réelle de l’anneau mentionné par son titre (Phoebe, Titan, Rhea, C-Ring, etc.), en offrant une progression concentrique jusqu’au centre du disque.
C’est par ce travail iconographique que les DJs et producteurs insèrent un univers sonore apparemment insignifiant, composé de bruitages et de stridulation, dans le fil d’une narration science-fictionnelle, suscitant l’expérience d’un ailleurs, d’un tout autre, d’une rupture radicale. Dans une interview pour une radio locale de Detroit, Mike Banks restitue l’origine de ce projet par la volonté de faire vivre une échappée sonore aux individus piégés dans une réalité urbaine en déclin. « On s’est demandé ce que ça ferait à l’un de ces pauvres gamins de Eight Miles de soudain traverser ces anneaux pour atterrir sur cette planète.[38] » Cette échappée sonore n’est pourtant pas une simple fuite consolatrice, qui dénierait totalement les conditions réelles d’une crise urbaine, sociale et économique. Elle permet plutôt d’envisager le renouvellement d’un imaginaire utopique malgré l’effondrement d’une utopie passée. Ou plutôt, c’est précisément grâce à l’effondrement de cette utopie fordiste, celle d’un progrès socio-économique par l’intégration des ouvriers dans la reproduction sociale du capitalisme, que l’invention d’un horizon radicalement nouveau devient possible.
L’imaginaire sonore élaboré au cours des années 1990 par la deuxième vague de la techno de Detroit, et notamment le label Underground Resistance, ne se résume donc ni au démantèlement brutal et sans concession de la promesse de réconciliation et de progrès social porté par le fordisme, ni au renversement dystopique de cette utopie passée. L’héritage soul, porteur d’une injonction au bonheur, n’est pas simplement enseveli sous les ruines de la crise urbaine ; il se voit plutôt transposé dans un véritable non-lieu, sans continuité avec le réel du capitalisme américain. Et cette dimension utopique de la musique techno de Detroit n’est jamais pure, mais elle se construit bien plutôt dans une tension irrésolue avec l’autre moment dystopique, risquant toujours de ressurgir, comme un avertissement, au sein de la conquête de nouveaux horizons sonores. C’est ainsi que l’alarme qui rugissait sur le Riot EP résonne à nouveau au moment où la tête de lecture rejoint le centre du disque The Rings of Saturn, lorsque l’auditeur atterrit au son du dernier titre « Groundzero ».
[INTERMEDE : « Groundzero », Resdiscover the Rings of Saturn, X-102]

La jouissance de la désintégration
Cette percée utopique qui ponctue certaines compositions de la techno de Detroit pourrait apporter une solution assez séduisante à l’énigme de l’expérience esthétique de la confrontation à ses sonorités brutales, répétitives, qui annulent la dimension harmonique de la soul et l’élément ludique des rythmiques funk. La pointe d’utopie qui ponctue certains morceaux offrirait une issue à la plongée dans l’abîme du non-sens par une soudaine échappée, en déclenchant un plaisir compensatoire d’autant plus puissant que l’agression précédente était brutale. Mais une telle interprétation pose deux problèmes : d’une part, elle empêche de rendre compte du plaisir potentiel de l’auditeur à l’écoute des nombreux titres de la techno des années 1990 qui annulent totalement l’élément soul dans une extinction de l’horizon utopique (un bon exemple en serait le cycle Waveform Transmission de Jeff Mills, en trois volumes, produits de 1991 à 1994 sur le label Tresor), et d’autre part, elle tend à conforter une interprétation fonctionnaliste de la musique festive, qui n’y voit qu’une production culturelle idéologique permettant d’adapter les individus à la réalité sociale existante, et notamment au mode de production du capitalisme tardif. Ce modèle d’analyse, hérité de l’approche développée par Adorno et Horkheimer dans leur essai sur la « production industrielle des biens culturels », assigne à la musique de l’industrie culturelle une fonction spécifique dans la reproduction sociale des rapports sociaux capitalistes. La finalité économique de cette musique — le profit dégagé par la vente de la marchandise musicale, ne serait que secondaire par rapport à la fonction idéologique d’embrigadement résultant de sa consommation esthétique. L’écoute « régressive » conditionnerait une forme de subjectivation adaptée au régime du travail salarié, notamment par la compensation libidinale de la souffrance engendrée par l’exploitation, offerte dans la sphère du temps libre et du loisir. Cette décharge affective résulterait de la « pseudo-individualisation » des « tubes », dissimulant la standardisation des schèmes de composition par des éléments de singularisation (syncope du rythme, variations ornementales des mélodies, intermèdes improvisés, etc.). La « standardisation » des comportements exigée par les nouvelles formes de travail sur des chaînes de montage serait ainsi intériorisée au cours d’un mécanisme psychique d’habituation facilité par le plaisir factice de la pseudo-individualisation, dispositif de dressage qu’Adorno résume en un parallèle qui fait implicitement référence à l’industrie du disque de Detroit : « le modèle Ford et le modèle d’un tube sont coulés dans le même moule[39] ». Outre cette fonction d’adaptation comportementale, la musique de l’industrie culturelle susciterait également — toujours selon Adorno — un effet d’intégration normatif au système de valeurs de la société capitaliste, produit par l’apologie d’un idéal de bonheur à portée de main, dissimulant les antagonismes de classe et l’accumulation de souffrance produite par l’exploitation. À la lecture de ces analyses réductrices, assumant un mépris élitiste à l’égard des inventions artistiques qui, à l’instar du jazz, font éclater les cadres de la composition musicale de l’avant-garde viennoise, on serait bien tenté de « jeter le bébé avec l’eau du bain ». Notons toutefois que ce modèle critique fut élaboré pour penser les créations culturelles spécifiques à une phase historique du capitalisme américain, caractérisée par l’intégration de la classe ouvrière dans le modèle fordiste de consommation, et qu’elle semble partiellement rendre compte de certaines caractéristiques des pratiques de production des grands labels comme la Motown, bien qu’elle n’épuise en rien toute la richesse des modes de réception et de réappropriation de la musique soul. Certains cédèrent à la tentation de le transposer terme à terme aux musiques électroniques des années 1990, au point de voir dans la culture rave un accomplissement d’un projet idéologique totalitaire envahissant toutes les sphères d’une existence en perte de sens[40]. Imbus de leur sagesse prophétique, ils contemplent la réalité sociale du haut de leur temple comme ces trois singes de pierre : l’un se bouchant les oreilles pour ne pas entendre cette musique dont il parle, l’autre fermant les yeux sur le monde dans lequel cette musique résonne, et le dernier bâillonné par des concepts vides qui ne disent que sa propre impuissance à laisser parler l’objet.
Il suffit pourtant de prêter l’oreille à la techno de Detroit pour voir s’effriter le moule du modèle critique de l’industrie culturelle qu’on serait tenté de lui appliquer de force. Loin de toute pseudo-individualisation, la logique de la répétition et de la composition par sampling assume entièrement la standardisation de son produit, sans la dissimuler, dans une forme d’exagération emphatique. Cette standardisation devient même un élément structurant de la production en studio, pour permettre aux DJs d’enchaîner les tracks lors des soirées, en calibrant le début d’un nouveau morceau sur la fin du premier dans un fondu enchaîné, nommé beatmatch[41]. Outre cette pratique assumée de la standardisation des produits musicaux, l’expérimentation bruitiste exacerbe la stridence d’une matière sonore empruntée à l’environnement industriel en déclin, en renonçant à toute finalité adaptative, à toute réconciliation avec le monde existant. En rappelant ces deux caractéristiques de la musique techno — standardisation assumée et mimesis négative — il ne s’agit pas ici de formuler un nouveau jugement abstrait et généralisant, mais de disqualifier l’hypothèse selon laquelle le plaisir de l’écoute serait simplement la résultante d’une compensation libidinale illusoire, dissimulant la négativité du réel. Cette analyse se contente d’assigner une fonction prédéterminée à l’objet musical, insérée dans la totalité d’un système clos, sans prendre en compte les multiples effets qu’il est susceptible de provoquer en fonction du contexte d’écoute.
Si les pratiques festives de la techno, notamment dans le développement de la culture du clubbing, peuvent viser une forme de plaisir compensatoire, en assumant le moto work hard, party harder, il n’est pourtant pas nécessaire d’y voir une fonction aliénante de l’économie psychique du capitalisme. Quand bien même l’expérience du plaisir dans l’écoute proviendrait d’une forme de compensation libidinale d’une accumulation de souffrance au travail, déchargée dans des moments de libération festive accompagnés d’un usage de drogues réconfortantes, on pourrait se contenter de constater cela comme un fait social nous renseignant sur les stratégies développées par les personnes exploitées pour continuer de vivre au-delà d’un travail consciemment vécu comme une exploitation aliénante. La production de cet effet compensatoire correspond toutefois à un contenu musical spécifique, à des potentialités propres aux musiques électroniques structurées par une résolution des tensions et la résorption de la négativité dans des élans réconciliateurs. Si l’on retrouve ces caractéristiques dans les variantes édulcorées de la techno issues de sa diffusion à grande échelle sur le continent européen, comme l’eurodance des années 1990, ou certaines variantes du genre aujourd’hui vaguement caractérisées d’électro, la techno de Detroit, ainsi que ses traductions les plus radicales dans les cultures raves (londoniennes et belges) et dans les récentes hybridations de techno et de noise[42], se prêtent plus difficilement à un tel usage. Il s’agirait donc de comprendre de quel type d’expérience esthétique relève la confrontation à la négativité comme négativité, en abandonnant l’hypothèse de la compensation.
Dans la théorie esthétique traditionnelle, c’est le concept de « sublime » qui fut élaboré pour rendre compte du plaisir suscité par la contemplation de la négativité, se déclinant comme disproportion, démesure, disharmonie ou laideur, autant de catégories qui s’opposent à la définition habituelle de la beauté. Encore faut-il expliquer d’où vient le « plaisir » procuré par cette expérience d’une agression sonore. La première réponse résiderait dans la mise en place d’un dispositif fictif, qui confronte l’auditeur à une expérience de l’effondrement ou de la destruction, tout en le préservant de la catastrophe et de son propre anéantissement[43]. Ainsi compris, le plaisir esthétique reste compensatoire : tout s’effondre, mais je survis[44]. La techno de Detroit n’est pourtant pas qu’une mise en scène sonore de l’effondrement d’un monde, le fordisme, mais également la déconstruction de l’« idéal » qui le sous-tendait. Or cet idéal n’est rien d’autre qu’un ensemble de croyances, d’espoirs, d’adhésions à un modèle de société qui structurent la subjectivité des individus intégrés par le capitalisme. Ce qui se joue dans la techno, ce n’est donc pas simplement l’effondrement d’un monde, mais aussi l’ébranlement d’une subjectivité intégrée par le modèle fordiste. Là où le mécanisme compensatoire décrit par Adorno et les contempteurs de la musique pop relève d’une forme de plaisir, qui opère comme une confirmation des attentes de l’auditeur, et un renforcement de la forme habituelle de sa subjectivité, le phénomène d’excitation libidinale propre à la techno relève plutôt d’une jouissance libérée par l’éclatement ou la dissolution de la subjectivité habituelle de l’auditeur, parfois exacerbée par l’usage de psychotropes[45]. Dans une nuit de rave extatique, l’individu s’abandonnant à la musique techno peut faire l’épreuve d’une désintégration jouissive de sa propre subjectivité intégrée, celle d’un travailleur adapté, discipliné et disponible pour l’exploitation salariale. L’actualisation de cette potentialité suppose que l’expérience soit totale, que la négativité soit assumée dans un excès radical et sans concession, une dépense purement improductive. Loin de se réduire à un effet subjectivant, qui adapte le cadre perceptif et normatif de la conscience individuelle au modèle du salariat intégré du fordisme, l’expérience limite de la techno peut produire un effet de désubjectivation, qui arrache l’auditrice à la disposition psychique normalement attendue par l’organisation sociale.
Bien évidemment, le type d’affect généré par l’expérience de la techno dépend non seulement du contenu musical, mais aussi du contexte spécifique de son écoute. Reste que la jouissance de la désintégration est bien une virtualité sonore de cette musique : non pas jouir du déclin d’un monde, le capitalisme fordiste, mais jouir de la désintégration d’une fausse promesse de réconciliation qu’il portait avec lui pour s’assujettir la force de travail.
Reste à se demander si cet effet « désubjectivant » potentiellement produit par l’expérience de la techno ne se rapporte qu’à une ancienne forme de subjectivité intégrée, fondée sur l’espoir projeté dans le salariat comme voie d’accès à la « Good Life », ou s’il peut également ébranler des dispositions psychiques propres au nouveau capitalisme postfordiste, dont le ressort émotionnel est moins l’espoir que le « stress ». Le salarié tertiaire moderne est soumis à une logique constante de gestion de projet, dans laquelle il devient l’entrepreneur de sa propre existence, calibrée par une norme de productivité étendue à tous les domaines du quotidien. Le « stress » est l’effet psychique d’une intériorisation de la contrainte salariale, qui permet de garantir une discipline nécessaire à un travail qui ne se déroule plus seulement sur une chaîne de montage sous haute surveillance, mais aussi dans l’open-space ou le domicile personnel du télétravail. Cette nouvelle gestion de la force de travail, celle d’une subjectivité flexible et adaptable (et non plus seulement adaptée), repose sur une captation de l’« angoisse », nourrie par le risque permanent d’une plongée dans la précarité et canalisée dans l’économie psychique d’un travail par projet. Ainsi refoulée, elle se voit convertie en stress et devient l’instrument sadique d’une exploitation de soi-même. Là où la subjectivation habituelle du capitalisme postfordiste opère par des stratégies d’évitement de l’angoisse, l’expérience négative de la techno s’offre à l’auditeur comme la confrontation la plus brute avec cet affect refoulé. Pour reprendre une expression employée par Mark Fisher dans un article sur la culture rave londonienne du début des années 1990, on pourrait décrire cette expérience dans les termes d’une « libidinisation de l’angoisse[46] ». L’auditeur peut résister à cette confrontation pour n’éprouver qu’un inconfort face à la brutalisation sonore, ou bien s’y plonger sans retenue pour atteindre cette pointe où l’angoisse refoulée se renverse en jouissance. Ce phénomène peut être interprété dans les termes d’une désubjectivation, dans laquelle le stress accumulé n’est pas rendu supportable par une compensation de plaisir, mais soudain déchargé de manière purement improductive, dans le désœuvrement d’une danse solitaire et interminable.
[INTERMÈDE : « Deathvox », Paula Temple]

Pour conclure
Cela ne fait aucun doute, la culture techno peut aujourd’hui être pratiquée, consommée et vécue comme un divertissement dominical réconfortant, par son insertion dans un rituel normalisé. Partir de ce constat pour la réduire à une fonction idéologique, celle d’une intégration adaptative des individus, c’est s’en tenir à une approche très superficielle de l’objet musical, oublieuse du contexte qui l’a vu naître, de son histoire, et de la multiplicité des pratiques qui le font vivre. Au contraire, c’est en laissant résonner, l’écho d’un effondrement, d’un abandon de tout espoir dans la réconciliation promise par le fordisme, qu’on peut comprendre l’expérience esthétique d’une jouissance éprouvée à même la négativité de la techno de Detroit.
Si la restitution du contexte d’émergence permet d’enrichir l’écoute de cette musique, d’approfondir notre expérience en la connectant à une expérience historique, l’étude de l’objet musical nourrit également la compréhension d’une certaine réalité sociale. Il ne faut toutefois pas attendre de la techno de Detroit qu’elle nous renseigne sur l’objectivité sociale, en l’occurrence la situation quantifiable et mesurable d’une classe ouvrière noire laissée pour compte par la crise du capitalisme fordiste. C’est là le rôle d’une histoire économique et sociale, non pas d’une étude de la culture, qui n’est jamais le simple reflet ou représentation d’une situation objective. Plutôt que des miroirs de l’état du monde, les productions esthétiques doivent plutôt être interprétées comme les prismes de son expérience subjective, en tant que mode d’expression d’individus qui se situent face au cours des choses. Entre espoir et mélancolie, attachement et détachement, fascination et angoisse, célébration et détestation, elles réverbèrent cette interprétation — consciente ou inconsciente — portée par les sujets que nous sommes sur leurs propres conditions d’existence.
sur la techno
Bredow Gary, High Tech Soul: The Creation of Techno Music, documentaire réalisé en 2006.
Cosgrove Stuart, “Motorcity Techno: Detroit’s new Robotsound”, The Face (mai 1988).
Derek Walmsley, Interview of Jeff Mills, Wire n°300 (2009).
Eshun Kodwo, More Brilliant than the Sun: Adventures in Sonic Fiction, London, Quartet Books, 1998.
Kosmicki Guillaume, Musiques électroniques. Des avant-gardes aux dancefloors, Paris, Le mot et le reste, 2016.
Pope Richard, « Hooked on an affect: Detroit Techno and Dystopian Digital Culture », Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Culture 2 (1): 24–44 .
Reynolds Simon, Generation Ecstasy: Into the World of Techno and Rave Culture, New York, Routledge, 1999.
Rubin Mike, « Techno. Days of Future Past », in Peter Shapiro (ed.), Modulations: A History of Electronic Music. Throbbing Words on Sound, New York, Caipirinha Production, 2000.
Sicko Dan, Techno Rebel: The Renegades of Electronic Funk, Detroit, Wayne State University Press, 2010 (2nd ed.).
sur l’histoire sociale de Detroit
Georgakas Dan et Surkin Marvin, Detroit, pas d’accord pour crever. Une révolution urbaine (1967-1975), (trad.) Laure Mistral, Marseille, Agone, 2015.
Sugrue Thomas J., The Origins of the Urban Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit, Princeton, Princeton University Press, 1996.
sur l’hypothèse de l’industrie culturelle
Adorno Theodor W. et Horkheimer Max, « La production industrielle des biens culturels », La Dialectique de la raison. Fragments philosophiques, (trad.) E. Kaufholz, Paris, Gallimard, 1974.
Adorno Theodor W., « Das Schema der Massenkultur » (1942), Dialektik der Aufklärung. Anhang, Frankfurt am Main, Fischer, 2000.
Adorno Theodor W., « Mode intemporelle. À propos du jazz » (1936), Prismes. Critique de la culture et de la société, (trad.) G. et R. Rochlitz, Paris, Payot, 2018.
Adorno Theodor W., « Sur la musique populaire », Current of Music, Éléments pour une théorie de la radio (1939), (trad.) P. Arnoux, Laval, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2010.
Adorno Theodor W., Le Caractère fétiche dans la musique et la Régression de l’écoute (1938), Paris, Allia, 2001.
autres
Fisher Mark, Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures, London, Zero Books, 2014.
Russolo Luigi, L’Art des bruits, Paris, Allia, 2013 (1913).
Toffler Alvin, The Third Wave, New York, Bantham Books, 1991 (1980).
[1] Deux exemples de ce retour : les soirées « Detroit Love » de Carl Craig, qui attirent des dizaines de milliers de fans à travers toute l’Europe, et la naissance d’un nouveau genre de techno brutale, très inspirée par Underground Resistance (le label Noise Manifesto avec Paula Temple, Rebekah, Amelie Lens, etc.).
[2] Cet idéal de réconciliation humaniste par le travail, dépassant l’antagonisme racial déchirant la société américaine, est représenté de manière très explicite par Diego Rivera, dans la célèbre fresque « Detroit’s Industry » qu’il peint en 1932 pour une commission de Edsel Ford, le fils de Henry Ford.
[3] Pour se faire une idée de ce long processus de désertion de la ville par les populations blanches (white flight), qui fait suite aux premières crises industrielles des années 1950 et ne cesse de s’aggraver après les années 1970, il suffit de comparer la démographie actuelle avec celle de l’après-guerre : 1,85 million d’habitants en 1950, dont 16 % de personnes noires, contre 710 000 en 2010, à son niveau le plus bas, avec 82 % de personnes noires.
[4] Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le méga-complexe industriel de la Ford River Roudge employait à lui seul 85 000 des 550 000 ouvriers de la ville tandis que l’usine de montage de la Packard faisait travailler 40 000 personnes.
[5] C’est le cas de l’interprétation de Guillaume Kosmicki, qui affirme « que la techno représente ainsi une libération symbolique de l’aliénation issue des machines qui sont un outil de domination depuis les révolutions industrielles du XIXe siècle », Musiques électroniques. Des avant-gardes aux dancefloors, p. 265.
[6] À première écoute, c’est bien cette fuite que l’on croit entendre en prêtant l’oreille à l’atmosphère cosmique qui enveloppe la production de nombreux titres des années 1990, comme la série « The Red Planet » dans laquelle Mike Banks réinvestissait un imaginaire déjà désuet de la conquête spatiale.
[7] On trouve un bon exemple de l’usage de cette dynamique harmonique dans le célèbre titre de Frankie Knuckles, « The Whistle Song ».
[8] À l’instar du phonème en théorie du langage, le « musème » désigne la plus petite unité de sens de l’expression musicale, qui ne peut pas être divisé davantage sans perdre sa fonction rythmique ou mélodique.
[9] La techno se distingue cependant de l’ambient, en ce qu’elle conserve une importante dimension rythmique, et donc un élément temporel constituant, et ne peut donc pas être identifiée à une pure spatialisation du son en un paysage sonore.
[10] Comme l’indique Simon Reynolds, la musique techno est exemplaire d’une métamorphose des musiques électroniques, abandonnant la dimension narrative de la tradition pop-rock pour endosser une dimension performative. « Tandis que le rock relate une expérience (autobiographique ou imaginaire), la rave construit une expérience », Simon Reynolds, Generation Ecstasy, p. 10.
[11] C’est le point de vue adopté dans le documentaire High Tech Soul. The Creation of Techno Music, mais aussi dans l’ouvrage de Dan Sicko, Techno Rebels. Il s’agit ici d’apporter une nuance à cette reconstruction, en soulignant que la techno n’est pas l’unique invention de ce trio fondateur des années 1980, mais que son originalité se cristallise progressivement, pour se dégager avec la seconde vague du début des années 1990.
[12] Les deux instruments qui caractérisent la signature sonore des musiques électroniques des années 1980, utilisés à la fois dans la house de Chicago et dans la techno de Detroit, sont la boîte à rythmes TR-909 et le synthétiseur de basse TB-303 de Roland, deux machines produites dans les années 1970 afin d’imiter les sons de batterie et de guitare basse. Elles tombent assez vite en désuétude en raison de leurs faibles prouesses techniques, et sont accessibles pour de modiques sommes aux DJs de Detroit. Ils en subvertissent l’usage, non plus en un sens reproductif, mais en un sens proprement créatif et expérimental. En témoigne Juan Atkins : « Depuis les cinq dernières années environ, la scène underground de Detroit s’est mise à expérimenter avec la technologie, pour l’élargir au lieu d’en faire un simple usage. Avec la chute du prix des séquenceurs et des synthés, l’expérimentation s’est intensifiée. », Juan Atkins, cité par Stuart Cosgrove dans The Face (mai 1988), « Motorcity Techno: Detroit’s new Robotsound ».
[13] Derrick May s’est lui-même beaucoup inspiré de la scène de Chicago, notamment de la musique de Frankie Knuckles dont il admire le potentiel festif et réconciliateur : « Lorsque je l’ai entendu jouer, et que j’ai vu la réaction des gens, leur manière de danser et de chanter les paroles — et de tomber amoureux les uns des autres — j’ai compris que c’était quelque chose de vraiment unique. Pas simplement être DJ pour jouer de la musique et partir en mission, mais jouer de la musique avec amour. La vision d’une telle euphorie, produite par la musique… ça m’a changé », cité par Dan Sicko dans Techno Rebel, p. 49. C’est aussi un producteur de Chicago, Terris Baldwin, qui pousse Kevin Saunderson à collaborer avec la chanteuse Paris Grey.
[14] Alvin Toffler, The Thid Wave.
[15] Cité par Stuart Cosgrove dans The Face (mai 1988), « Motorcity Techno: Detroit’s new Robotsound ».
[16] La techno est probablement la première forme de musique contemporaine noire qui rompt catégoriquement avec le vieil héritage de la musique soul. Contrairement à la house de Chicago […], la techno de Detroit réfute le passé. […] Sa préférence va à la technologie de demain plutôt qu’aux héros du passé. La techno est un son postsoul. Elle n’a rien à dire au Seigneur, mais pousse le volume sur le dancefloor », Stuart Cosgrove, ibid.
[17] Sa relecture des musiques noires américaines du dernier XXe siècle se fonde sur une opposition entre la tradition soulful et l’expérimentation postsoul, annulant l’élément humaniste et chaleureux de la musique « afro-américaine » pour lui substituer l’artifice de la machine (chapitre 1). Il considère la techno de Detroit, et notamment les productions de Underground Resistance et de Drexciya, comme l’un des points d’aboutissement de cette rupture (chapitre 7).
[18] Cité par Stuart Cosgrove, « Motorcity Techno… ».
[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] Cité par Adam White, dans une interview au sujet de son livre Motown: The Sound of Young America, 2016 (https://www.franceculture.fr/emissions/continent-musiques/une-histoire-de-la-motown-par-adam-white). L’enregistrement du célèbre discours de Martin Luther King du 23 juin 1963 est lui-même paru sous forme d’un album de la Motown sous le titre The Great March to Freedom au mois d’août de la même année...
[22] « I say a little prayer for you », un tube d’Aretha Franklin façonné par la Motown, offre un bon exemple de la traduction de l’espoir messianique en un avenir meilleur, animant les chants gospels, en la célébration de la vie quotidienne. Si dans le premier tube produit par la Motown chanté par Barett Strong, « Money (that’s what I want) », l’idéal romantique est nuancé par les nécessités économiques, ce n’est que pour réaffirmer le pouvoir de l’argent comme objet ultime du désir : « Your love gives me such a thrill, but your love don’t pay me the bills […] Money, lots of money, whole lots of money, all what I want, woah yeah, give me money ».
[23] Un seul exemple : en 1954, seuls 24 ouvriers noirs sont employés parmi les 7425 ouvriers qualifiés de Chrysler, alors même que la composition globale de la main-d’œuvre de l’usine comptait un quart d’ouvriers noirs. Les premières mesures contre la discrimination dans l’emploi ne sont prises qu’avec l’entrée en vigueur de la Fair Employment Practices Law en 1955, mais celle-ci ne limite que partiellement les recrutements sur des critères racistes en interdisant les bureaux de recrutement spécifiquement réservés aux blancs ou aux personnes de couleur, sans pour autant pouvoir empêcher l’arbitraire des pratiques de recrutement (cf. Thomas J. Sugrue, The Origins of the Urban Crisis, p. 97).
[24] Cette dénonciation du lyrisme sous-jacent de la culture soul est un thème central de la culture du Black Power se développant à la fin des années 1960. Le poème-manifeste d’Ami Baraka, intitulé « Black Art », peut être interprété comme une première rupture esthétique avec cette positivité de la culture soul : « Let them no love poem be written/ Until love can exist freely and/Cleanly » (« Ne leur laissez écrire aucun poème d’amour/Avant que l’amour puisse exister librement et/Proprement ») rupture qui sera reprise et approfondie par différentes traditions musicales, comme le free jazz d’une part, mais aussi la techno de Detroit dans le champ des musiques électroniques.
[25] Cf. Thomas J. Sugrue, The Origins of the Urban Crisis, p. 259.
[26] Jeff Mills relate cette expérience dans une interview pour le magazine Wire, n° 300 : « Well for me, maybe one of the most influential things that happened was during the riots in Detroit in 67. My parents decided to pack the family up and take the family out of the country because it was too violent in Detroit – it primarily happened in our neighbourhood in Detroit, where all the bombings and all the police and the army came in, and they declared martial law. »
[27] C’est cette intention qui transparaît dans la vidéo éditée récemment par Mike Banks, dans un clip posté sur Youtube où il illustre le morceau « Riot » par des images des soulèvements politiques des dernières années, notamment du Printemps arabe : www.youtube.com/watch?v=T7rsoxAojhs
[28] Ces groupes, comme Front 242 ou Nitzer Ebb, sont des références importantes pour la jeunesse de Detroit.
[29] Cf. Dan Sicko, Techno Rebels, « Origins of a Sound », p. 109.
[30] L’exemple le plus frappant en est la bataille autour du titre « Jaguar » de DJ Rolando, qui fut récupéré par Sony dans une reprise à l’identique, avant d’être produit une seconde fois dans une version modifiée et exclusive par Underground Resistance. Cf. Dan Sicko, Techno Rebels, p. 104.
[31] Malice Green est brutalement assassiné par la police de Detroit en 1992 à l’occasion d’un contrôle routier, suspecté de dissimuler de la drogue dans son véhicule au moment où il cherche son permis de conduire. Cette violence policière à caractère raciste n’a fait que s’aggraver suite aux émeutes de 1967, avec un pic particulièrement sauvage dans les années 1970 qui voient la création d’une brigade spéciale de police, le STRESS, simulant des agressions pour justifier des crimes sanglants. On ne compte pas moins de 7,17 civils tués pour 1000 agents de police en 1971, soit cinq fois plus qu’à New York à la même époque. Cf. Georgakas et Surkin, Detroit, pas d’accord pour crever.
[32] Luigi Russolo, L’art des bruits, p. 12.
[33] « Les moteurs de nos villes industrielles pourront dans quelques années être tous savamment entonnés de manière à former de chaque usine un enivrant orchestre de bruits. », ibid., p. 28.
[34] Detroit: City on the Move, documentaire promotionnel réalisé par James T. Slayden.
[35] Le chômage structurel qui s’installe suite à la crise économique touche de manière très différenciée les travailleurs noirs et les travailleurs blancs. Dans les années 1950, environ 16 % des travailleurs noirs sont au chômage, contre 6 % des blancs, écart encore accru dans l’industrie automobile où les taux sont respectivement de 20 % et de 6 % (Thomas J. Sugrue, The Origins of the Urban Crisis, p. 144).
[36] « I wish i could escape from this crazy place/ Fantasy or dream, I’ll take anything/ Suddenly surprise, right before my eyes/ All I see are stars, and other cosmic cars ».
[37] Le pseudonyme X-102, sous lequel cet album est paru au label Tresor en 1992, dissimule en réalité Jeff Mills et Mike Banks, qui ont réédité une version numérique et augmentée de l’album en 2008, portant le titre Rediscovers the Rings of Saturn.
[38] Mike Banks, dans une interview donnée dans une émission de Detroit Public Radio consacrée au travail du label : www.mixcloud.com/machinemelodies/mad-mike-underground-resistance-interview-part-1/
[39] Theodor W. Adorno, « Das Schema der Massenkunst », appendice non traduit à « La production industrielle des biens culturels », p. 346.
[40] Tiqqun, « Le sermon au Raver ».
[41] Dans son album Cycle 30, Jeff Mills pousse ce principe de la standardisation jusqu’à ces dernières conséquences en enregistrant sur le vinyle des boucles fermées (lock groove) qui répètent incessamment un motif de quatre battements, et que le DJ peut ensuite utiliser pour les insérer manuellement dans son mix.
[42] Avec son label Noise Manifesto, fondé en 2015, Paula Temple se présente comme l’une des figures de proue du renouvellement contemporain de la techno, fortement influencée par la musique Detroit dont les accents dystopiques sont poussés à l’extrême saturation, dans un genre qu’elle nomme « Technoise ».
[43] C’est notamment de cette manière que Kant se propose d’expliquer philosophiquement l’expérience du sublime : la contemplation esthétique d’une destruction de notre existence physique par des cataclysmes naturels nous rappelle que notre propre âme (qu’il nomme « la subjectivité transcendantale ») survivrait malgré tout à l’anéantissement physique du corps (Kant, Critique de la faculté de juger, « Analytique du sublime », § 28, « De la nature comme force »).
[44] C’est notamment l’hypothèse défendue par Richard Pope, dans son article « Hooked on an affect: Detroit Techno and Dystopian Digital Culture » : « Une chose est sûre, les sentiments fugaces d’extase utopique accompagnent bien ceux qui s’ajustent sur une vie dystopique : ce sont des affects survivalistes, propres au fait d’avoir survécu et par conséquent d’être dans le moment présent (car il n’y en a pas d’autre). Il y a quelque chose de cet ordre dans la techno de Detroit, comme dans la culture rave en général », p. 29.
[45] Le type de drogue majoritairement consommée dans les soirées techno est particulièrement instructif. Plutôt que la cocaïne, ayant pour effet d’exacerber les facultés de concentration et les performances de l’individu, et permettant potentiellement d’accroître la productivité du travail, c’est la MDMA, consommée pure ou en cachet d’ecstasy, qui est devenu le psychotrope favori des amateurs de musique techno. Elle provoque l’abandon à des sensations corporelles exacerbées et à une empathie débordante, conduisant l’individu à s’oublier complètement dans l’expérience musicale, en une sorte de transe purement improductive. La conjonction des psychotropes à l’écoute festive de la techno n’eut pas lieu à Detroit, où la drogue était directement associée à la misère régnant dans les ghettos, mais lors du développement de la première culture rave londonienne, au début des années 1990. Elle atteste toutefois d’une potentialité de cette musique, dont la texture sonore semble résonner tout particulièrement avec les effets psychiques de la MDMA. À ce sujet, voir notamment Simon Reynolds, Generation Ecstasy, ch. 4 « Ecstasy and rave music ».
[46] Mark Fisher, Ghosts of My Life, chapitre « Ghost of my life: Goldie, Japan, Tricky ».